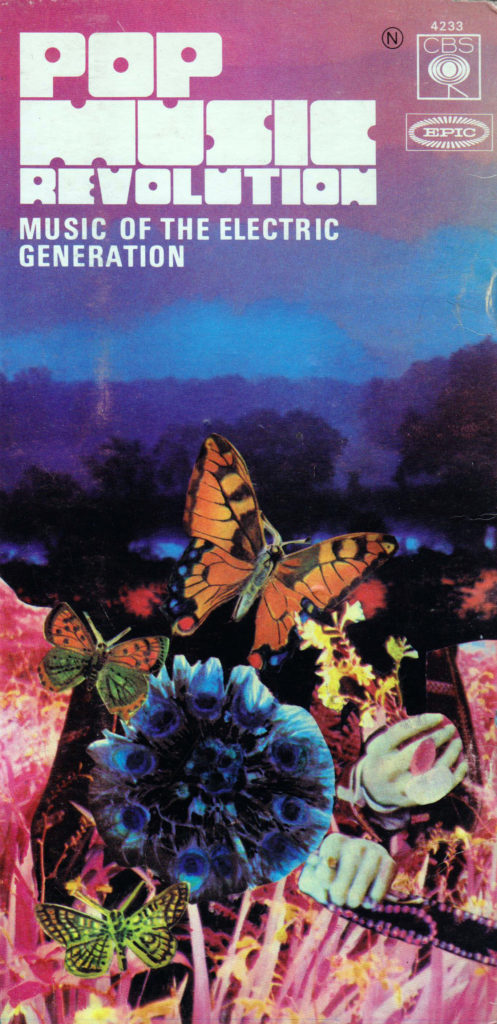La diffusion par interrelations
Mais la diffusion n’est pas que verticale, de haut en bas ou de bas en haut. Elle peut tout aussi bien être horizontale. Elle se propage alors au sein de groupes de personnes qui ont des interactions, se côtoient, ont des intérêts communs, appartiennent à un même réseau, que Clyde Mitchell qualifie comme un « ensemble particulier d’interrelations au sein d’un groupe limité de personnes, avec la propriété supplémentaire que les caractéristiques de ces interrelations, considérées comme une totalité, peuvent être utilisées pour interpréter le comportement social des personnes impliquées ». Un tel phénomène d’interrelations générateur d’innovations a pu être observé, au début des années soixante, entre le milieu littéraire issu du mouvement Beat et les milieux musicaux contestataires folk ou hippie. A cette même époque, un groupe issu des milieux existentialistes littéraires allemands avait influencé la transformation des Beatles en une entité musicale originale.
L’adoption par le système
Everett Rogers s’est également intéressé à la relation entre les individus et le système dont l’individu est membre. La similitude et la disparité des acteurs confrontés à l’innovation sont des facteurs essentiels dans son adoption et son acceptation. Il en conclut qu’ « une innovation est une idée, une pratique ou un objet qui est perçu comme nouveau par un individu ou un collectif d’adoption », où le mode de diffusion a pour mission de véhiculer cette nouveauté. C’est aussi une forme spéciale de communication. Cette communication est un processus à double direction engendrant un degré d’incertitude qui impacte la forme de la diffusion produisant un manque de prédictibilité : il n’existe pas de choix basé sur des alternatives connues. L’adoption de l’innovation, pour être massive, nécessite alors de relier des mondes sociaux éloignés, entre des individus précoces et faciles à convaincre (aventuriers, visionnaires) et des individus pragmatiques, réfractaires à la prise de risque, qui souhaitent des références clairement établies. Le temps nécessaire à la diffusion des innovations sera plus ou moins long en fonction de certains facteurs endogènes (résultant des caractéristiques intrinsèques des innovations) et exogènes (résultant de l’environnement dans lequel les innovations sont introduites).
Mesurer l’innovation?
Pour Rogers, une mesure objective de la pertinence de la nouveauté réside dans le laps de temps qui s’écoule entre la première utilisation – la découverte – et l’adoption réelle. La diffusion de l’innovation sera plus ou moins rapide et étendue en fonction de son avantage relatif par rapport à l’idée qui est remplacée, de la cohérence de la nouvelle idée avec les valeurs existantes, des expériences passées et des besoins des potentiels adoptants. Les conditions dans lesquelles l’innovation est perçue – à savoir l’évaluation qui est faite du niveau de difficulté à la comprendre et à l’utiliser – vont également jouer un rôle essentiel à son adoption, de même que la possibilité de la tester avant une utilisation définitive et la diffusion de retours d’expériences par d’autres utilisateurs.
Extrait de « Parfois ça dégénère », Marc Alvarado, Ed. Bookelis, 2020